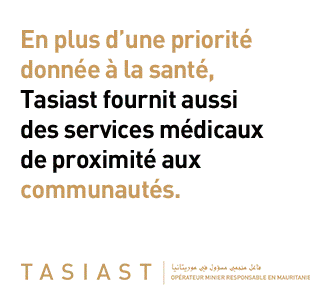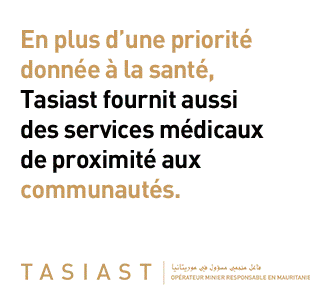Les Nouakchottois l’ont constaté. Un discours contestataire est en train de faire son chemin au sein de la communauté des forgerons. Des écriteaux étaient subitement apparus sur les murs de Nouakchott, il y a plus de deux mois de cela, demandant plus de considération pour cette communauté et l’arrêt de sa marginalisation.
Puis, une structure dite «l’initiative des forgerons pour la lutte contre la marginalisation» a vu le jour et commencé à donner des conférences de presse, dont la dernière le 8 décembre 2012 à Nouakchott. Que disent les organisateurs de cette initiative? Eh bien, comme TPMN, ils disent que l’anniversaire de l’indépendance (28 novembre) leur rappelle l’injustice dont est victime leur communauté. Ici, la comparaison releve bien évidement du sentiment d’injustice et non de la nature de celle-ci, car pour TPMN le 28 novembre, c’est le souvenir des affreuses pendaisons d’Inal.
En présence du secrétaire général de l’initiative, Mohamed Lemine Ould Wavi, son président, Cheikh Ould Beiba a mis en garde contre la colère de milliers de forgerons face à leur marginalisation , laquelle, pourrait conduire la Mauritanie au modèle somalien.
«C’est pour lutter contre la marginalisation de cette communauté qui représente 20% de la population mauritanienne que nous avons créée cette initiative» a précisé Ould Beiba . Et les organisateurs d’enchainer avec d’autres griefs notamment l’exclusion des forgerons des postes politiques, administratifs et des élus.
«Sur plus de 200 maires élus, il y a pas un seul forgeron. Nous lançons ici des messages pacifiques mais si rien n’est envisagé pour notre communauté nous descendrons dans la rue pour laver l’humiliation de notre communauté», a prévenu Ould Beiba laissant entendre que les forgerons pourraient bien s’inspirer des modèles de lutte de IRA et TPMN en pointe sur les questions de l’esclavage et sur les préoccupations des negromauritaniens.
Stigmatisés et même raillés dans l’imagerie populaire, les forgerons ne tombent pourtant pas du ciel!
Ils sont d’authentiques Maures d’origine sanhaji, arabe ou africaine et ont toujours constitué une caste spécialisée au sein des différentes tribus de l’anarchiste ensemble maure, où tout y était vague, imprécis et flottant depuis les Sanhaja et les Beni Hassanes, jusqu’à la pénétration coloniale en 1900.
A quelques rares exceptions, ces ensembles n’avaient pas de territoire géographiquement et politiquement déterminés. Ils détestaient même, la ville. Le groupe n’était en fait qu’une agglomération de races et de tribus diverses. Les tribus se dispersaient et se répandaient en groupements différents, instables, remuants, vagabonds, indépendants et désordonnés où seuls, les chefs régnaient par la force, nous renseigne un administrateur des colonies, George Poulet dans son excellent ouvrage «Les Maures de l’Afrique occidentale française» paru en 1904.
Dans cet univers, précise-t-il, les marabouts impuissants, les tributaires et les castes opprimées (dont celle des forgerons) y étaient résignées et à la fois, mélangées et distinctes.
Au niveau du mental collectif, les choses ne semblent pas avoir énormément évolué, un siècle après que l’école eut supplanté la mahadra, et l’Etat, le chef de tribu ou de... gang.
Elles sont en grande partie restées ce qu’elles étaient du temps de la Badiya.
D’ailleurs même après l’Etat-Nation et au gré des changements politiques, la stigmatisation touche de temps à autre des groupes qui ne le furent pas historiquement.
C’est pourtant grâce au travail et au génie incontestable de la caste des forgerons, que nous avions eu les mors, les étriers, les sabres, les bijoux, les calebasses, les pipes, les briquets, les portes, les lits, le cuir travaillé et bien d’autres produits qui font notre patrimoine et notre fierté.
Mais pourquoi sommes nous si fiers du produit, et pas de celui qui l’a produit? Une question qui résume, parmi tant d’autres, nos contradictions.
IOM
|