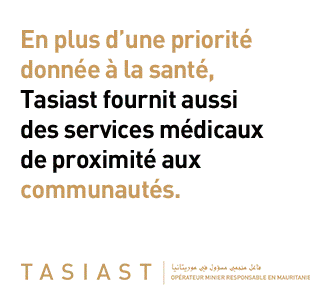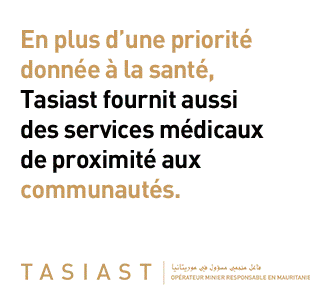| Les cinquante "pays les moins avancés" (PMA) de la planète ont affiché en 2004 et 2005, de bons résultats macro-économiques, selon le rapport annuel de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) publié jeudi 20 juillet. Cependant, de profondes inégalités sociales demeurent et se creusent encore davantage.
La croissance économique n’a jamais été aussi forte depuis vingt ans (5,9 %). Cette performance s’explique par l’afflux des investissements directs étrangers (IDE, 10,7 milliards de dollars), la flambée des exportations de marchandises (57,5 milliards de dollars), due à l’explosion de la demande et des prix des matières premières, et l’accroissement de l’aide internationale (24,9 milliards de dollars).
Mais ces chiffres dissimulent, selon la CNUCED, de profondes inégalités, tant entre les pays, qu’à l’intérieur de chacun d’entre eux.
Tout d’abord, les IDE sont concentrĂ©s dans l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles, qui forment d’ailleurs l’essentiel des exportations. Ce sont donc quatre pays producteurs de pĂ©trole (Angola, GuinĂ©e Ă©quatoriale, Soudan et YĂ©men) qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă eux seuls de plus de la moitiĂ© de la hausse des exportations. Avec la Mauritanie et le Tchad, deux autres pays pĂ©troliers, ces quatre États ont en outre absorbĂ© 70 % des IDE.
Or, constate la CNUCED, ces activitĂ©s extractives, essentiellement contrĂ´lĂ©es par des grandes entreprises occidentales (les secteurs Ă©nergĂ©tiques et de tĂ©lĂ©communications notamment), crĂ©ent peu d’emplois. La libĂ©ralisation des Ă©changes, la privatisation des grandes entreprises d’État, l’entrĂ©e de ces pays dans le commerce mondial, leur ont certes permis d’afficher de bons rĂ©sultats macro-Ă©conomiques, mais n’ont pas crĂ©Ă© un secteur productif local, constituĂ© de petites et moyennes entreprises dans l’agriculture, l’industrie et les services, seules susceptibles d’absorber la main-d’œuvre et d’apporter des revenus suffisants Ă la population.
De plus, l’aide au dĂ©veloppement, qu’elle provienne des États, des agences internationales (ONU, Banque mondiale, Fonds monĂ©taire international) ou des organisations non gouvernementales des pays riches, s’est concentrĂ©e sur les secteurs de l’éducation et de la santĂ©, afin de pallier les dĂ©fauts des services publics mis Ă mal par les cures d’austĂ©ritĂ© budgĂ©taire imposĂ©es par les politiques macro-Ă©conomiques d’ajustement. Ceci aux dĂ©pens, estime la CNUCED, de l’aide au secteur productif, en particulier dans les zones rurales.
Pour créer les conditions d’un développement durable, générateur d’emplois et de richesses pour les populations locales, jugent les experts de la CNUCED, l’aide internationale et les politiques économiques publiques doivent être réorientées vers la construction d’infrastructures (transports mais surtout énergie) et la mise en place de systèmes de financement (crédit et investissement), afin de permettre la croissance des échanges sur le marché intérieur et la multiplication de PME intermédiaires entre les petites exploitations agricoles et les grandes entreprises internationales.
Développer les capacités productives
Tout le monde est presque unanime sur le fait que le développement des capacités productives est indispensable à une croissance économique soutenue dans les PMA. C’est en développant leurs capacités productives que ces pays seront à même de mobiliser davantage de ressources intérieures pour financer leur croissance économique, de réduire leur dépendance à l’égard de l’aide, et d’attirer des flux de capitaux privés susceptibles de soutenir leur processus de développement. Dans ce sens, en Mauritanie, le secteur bancaire devrait bénéficier de l’arrivée de la Banque Internationale d’Investissement, et celle prochaine de BNP Paribas
Pour tirer parti des progrès technologiques récents, les PMA ont l’obligation de se rapprocher de divers seuils en matière de capital humain, de recherche-développement et de gestion, et de les dépasser. Ce que la plupart de ces pays n’ont pas réussi à faire, faute de ressources, ou de volonté politique.
Malgré les progrès accomplis dans les années 90, la formation de capital ne représente encore que 20% du PIB mauritanien, et l’investissement privé intérieur est particulièrement faible. Pour favoriser une plus forte création d’emplois, ce taux doit se maintenir à 35% au moins.
|