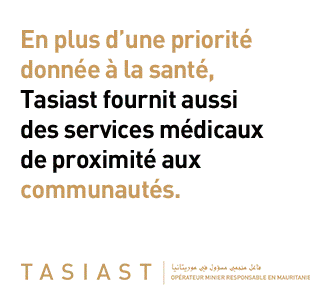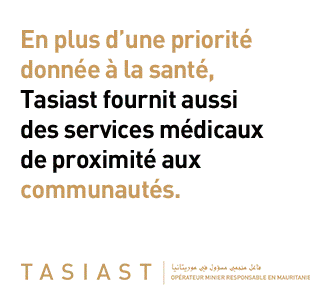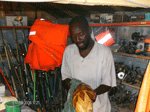
Il y’a encore quelques années, le quartier du wharf profitait d’un statut particulier : il était largement méconnu de la majorité des nouakchottois. Son évocation renvoyait dans la mémoire collective à un site perdu dans les confins de l’océan. Hormis ses habitants qui ralliaient quotidiennement la ville, la distance constituait une barrière suffisante pour le gros des citadins.
Seulement, voilà , la ville de Nouakchott s’est tellement agrandie que plus aucun pouce de terrain ne demeure vierge. Mais, au quartier du wharf, on vit toujours comme il y’a trois décennies. Mis à part le climat relativement doux, bien de galères accompagnent la vie des populations.
Petite agglomération d’une cinquantaine de logements que les autorités du wharf de Nouakchott avaient construits pour y installer leurs employés, le quartier à qui on a attribué le nom de l’infrastructure portuaire a vu, depuis, se greffer autour de lui des centaines de baraques. Cette occupation sauvage de terres que l’on connaît si bien sous les cieux de notre capitale a fini par phagocyter les quarante neuf bâtiments initiaux. Seules les bâtisses de la cité douanière situées sur la droite de la route bitumée ont échappé à la boulimie de la «gazra». De sérieux problèmes ont depuis lors surgi dans l’environnement de ces gens. En effet, dans ces milieux en grande majorité ouvrières et martiaux, le boom démographique est manifeste. C’est ce qui explique que par moments, la cité donne l’air d’être minuscule pour les populations qu’elle abrite, d’où un malaise visible chez les jeunes que l’on voit traîner tout le long de la journée devant les quelques commerces de la place ou les rudimentaires salles de jeux installés ici et là . Les adultes, pour ceux qui bénéficient de logements officiels, sont soldats, gendarmes ou personnes travaillant en ville. Les locaux en question sont pratiquement tous sous-loués par les bénéficiaires initiaux. C’est un système très courant ici dit-on. Une chose est quand même remarquable au wharf, c’est que les gens, quelque soit leur statut ou leurs activités, partagent une activité commune : la pêche. Ceci est dû à la proximité d’avec la mer. C’est pourquoi les après-midi, il n’est pas rare de voir des soldats troquer le treillis contre une tenue de pêche. Il en est de même pour des salariés ordinaires. D’autres, n’ont aucune autre source de revenus que la pratique de la pêche. Ces gens là s’y adonnent à temps plein. Mais comment ? C’est le cas de Mohamed Ould Boyeh (photo en illustration). La quarantaine bientôt entamée, l’homme jouit d’un respect certain dans le quartier du wharf. Il est tout aussi incontournable au niveau de son quartier qu’il constitue une référence avérée sur la jetée du vieux port où les pécheurs aguerris vous diront toujours : « Va voir Mohamed ! » pour une canne à pêche cassée, un moulinet inopérationnel ou le meilleur site de pêche sur les côtes de nos plages.
Les avatars d’un environnement déprimant
Le natif du quartier côtier ne baigne pas dans une mer d’optimisme, parlant de son bled : «Vivre au wharf aujourd’hui est loin d’être agréable. Nous faisons face à d’énormes problèmes d’existence. En effet, le principal souci est celui du manque d’eau. Il n’y en a pas ici. Regardez ces centaines de bidons posés là . Leurs propriétaires attendent que la citerne que vous voyez à côté soit remplie pour qu’ils puissent s’approvisionner. Et pour remplir la citerne, nous comptons sur une femme d’origine russe du nom d’Elena qui nous envoie régulièrement de l’eau .C’est par mes soins que nous avons obtenu cette aide. Lorsque l’eau nous manque c’est moi-même qui l’appelle de mon téléphone et aussitôt elle nous envoie un camion-citerne. » Pendant que Mohamed évoque les turpitudes de la vie dans cette excroissance de Nouakchott, l’on peut lire sur son visage le sentiment de dépit reconnaissable chez les personnes leaders mais totalement désarmées devant une adversité envahissante. Il a beau montrer un calme olympien, l’expression des traits de son visage traduit un grand découragement. Il ajoute : « Nous sommes victimes d’une pollution à grande échelle. Nous respirons la poussière des deux cimenteries dont vous pouvez voir l’impact sur les maisons. » En effet, une pellicule grise recouvre toutes les surfaces présentes. Il poursuit ! « Il en est de même pour les deux usines de gaz. Tout dépend de la direction du vent. S’il tourne de notre côté, nous ne respirons que de la poussière et du gaz. » Le problème de ce quartier réside également dans le fait que les produits de consommation de première nécessité s’obtiennent à des prix faramineux. En effet, du fait de la distance qui sépare le coin des grands centres urbains, les quelques commerces existants taxent au plus fort les riverains. C’est ainsi que le kilogramme de sucre s’y vend à 200 um contre 140 um en ville, Le kilogramme de riz à 250 um contre les 200 um fréquents. Les sardines, menu quotidien des démunis se vendent 80 um la pièce tandis que dans les marchés, leur prix est de 20 um. Un véritable goulot d’étranglement pour ces masses vulnérables.
La solution au féminin
C’est pour juguler cette situation que quelques femmes ont eu l’idée de mettre sur pied une boutique communautaire. Cette trouvaille ô combien judicieuse a le mérite de permettre à ses membres de contourner les spéculateurs et de faire profiter les résidents de ses avantages. Hawa Mint Hebboul, assise aux côtés de Messaouda Mint Habib éclaire : « Nous sommes 26 femmes à avoir déboursées 12 000 um chacune pour monter cette boutique. Il y’a trois ans de cela. Nous nous organisons pour que de manière cyclique, trois femmes tiennent le commerce pendant un mois au bout duquel, les bénéfices sont partagés en deux parts égales. Une va à la boutique, l’autre revient aux femmes en question. » Hawa de poursuivre : «Que voulez-vous ? Il faut bien vivre. Les prix que nous pratiquons sont bien moins chers que ceux des boutiques. De plus, même si je ne dispose que de 100 um, je peux obtenir tout ce dont j’ai besoin sur crédit. C’est tout le monde qui y gagne ! » Le groupe de femmes présentes acquiesce. Elles sont toutes membres associées de la boutique et même lorsqu’elles ne sont pas de service, elles viennent tous les jours deviser ensemble sur le perron de leur avoir commun. Comme quoi malgré l’éloignement et l’absence de toute perspective riante, tout le monde n’a pas baissé les bras. En attendant, une armée de femmes et d’enfants ont pris position devant la citerne d’eau et attendent l’eau d’Elena pendant que les camions pelleteuses et la cheminée de Ciment de Mauritanie crachent une fumée grisâtre sur les têtes. C’est la vie et, nous sommes au wharf.
Biri N’diaye
Mohamed Ould Boyeh, il y est né et y a grandi
Mohamed Ould Boyeh est sans aucun doute ce que l’on peut appeler la personne ressource par excellence. OĂą que l’on tourne dans sa citĂ©, il y est omniprĂ©sent tant il a liĂ© sa vie Ă celle du quartier du wharf. Il a Ă©tĂ© Ă bonne Ă©cole car il y est nĂ© et y a grandi. L’homme s’investit dans toutes les activitĂ©s du quartier mais son occupation première demeure la pĂŞche. Tout petit dĂ©jĂ , il a appris le ba ba de la prise des poissons. La pĂŞche est toute sa vie. C’est pour cette raison qu’il y consacre tout son temps. Il quasiment impossible de trouver Ă Nouakchott et probablement ailleurs en Mauritanie quelqu’un qui connaĂ®t mieux que lui l’art de la pĂŞche, les meilleurs sites de pĂŞche mais aussi les dessous et secrets de la canne Ă pĂŞche. Dans son atelier situĂ© sur le bord de la route du wharf, l’on trouve des centaines de cannes et des moulinets en très grand nombre. Ils sont lĂ pour rĂ©paration. En effet, l’homme passe pour ĂŞtre maĂ®tre dans la rĂ©paration du matĂ©riel de pĂŞche. Mohamed, c’est aussi celui qui approvisionne les pĂŞcheurs en plombs et en cuillères dont il a le seul secret de prĂ©cision dans la fabrication. L’intĂ©rieur de l’atelier rĂ©vèle Ă©galement des objets d’art. Ce sont des coquillages sur lesquels il a apposĂ© des figures et des arabesques mais Ă©galement des colliers fait Ă partir d’arĂŞtes de poissons. Mohamed a tout pour bien vivre de sa passion mais il se plaint d’un dĂ©ficit de reconnaissance : « Je ne suis pas enregistrĂ© au ministère de l’Artisanat et du Tourisme. Je voudrais avoir un papier ou un badge signĂ© par le ministère pour pouvoir exercer mon mĂ©tier de guide. Tenez quand je me rends au Banc d’Arguin avec des touristes ou autres expatriĂ©s, les soldats m’empĂŞchent d’entrer. Ils veulent de l’argent. Ça n’est pas normal ! » Tout en parlant, il exhibe des photos immortalisant des prises de pĂŞche antĂ©rieures. « Je possède un site Internet c’est : pĂŞcheaubancd’arguin.blogspot.com et j’aimerais que l’on me laisse faire mon travail de guide ; c’est ce manque Ă gagner qui m’a poussĂ© Ă ouvrir cet atelier.»
|