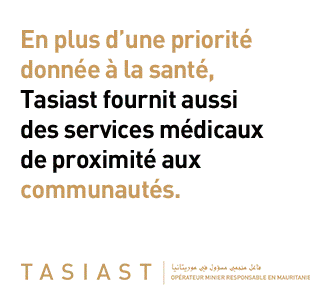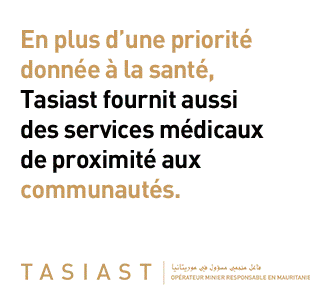| La gouvernance et le consensus politique national. Quels sont leurs impacts sur le niveau vie des citoyens? Autrement dit, existe-t-il réellement une relance économique en Mauritanie?
Certes, nous avons assisté à des journées de concertation débouchant sur une modification constitutionnelle limitant le mandat présidentiel à deux mandats non renouvelables, mais il est question de savoir comment évaluer l’action de l’actuel gouvernement. D’où la problématique de la concrétisation du discours mémorable du «Boss» au Palais des Congrès. Ce discours prônait la transparence dans la gestion publique. Le chef de l’Etat n’avait-il pas souligné que «les choix à cet égard ne sont pas multiples : nous devons choisir entre l’anarchie, la confiscation du pouvoir ou une toute autre voie, celle consistant à accorder au peuple, à tous les citoyens, le droit de gérer eux-mêmes leurs affaires et ne pas les laisser aux mains d’un pouvoir qui ne les utilisera que pour ses propres intérêts.
Si nous délaissons notre avenir, je vous le dis, nous en payerons chèrement le prix (…). Or, depuis un an, c’est une vraie révolution à laquelle nous assistons dans les domaines des libertés et de la bonne gouvernance. Avant le 3 août, la Mauritanie marchait sur la tête. Désormais, elle se tient solidement sur ses jambes.»
On se souvient que des anciens gouvernements avaient entamé -armés sans doute de bonnes intentions- une série de démarches qui devaient permettre l’élaboration d’un cadre juridique pour une gestion rationnelle de la chose publique. L’universitaire Moktar Fall Ould Mohamed confirme en ce sens que « les pouvoirs publics mauritaniens avaient opté pour une large politique de décentralisation depuis les premières années de l’indépendance.
Cette politique de décentralisation a été sans résultat du fait de l’insuffisance de moyens humains et financiers d’une part et de la précarité de l’état d’esprit des populations et le retard des mentalités d’autre part. C’est pourquoi les pouvoirs publics de l’époque étaient revenus sur la décentralisation politique et avaient introduit une large régionalisation.»
Dans la période de transition actuelle, les pouvoirs publics misent sur l’inspection générale d’Etat et la cour des comptes pour améliorer la qualité de contrôles. L’évolution budgétaire de la cour a connu une nette procession de 80% entre 1999 et 2003. Ce qui équivaut à 118 millions d’ouguiyas en 2003 contre 63 millions 1999. Toutefois, le facteur humain au sein de cette institution reste insuffisant. A souligner que des agents d’Etat ayant détournés des biens publics préservent toujours leurs places. Pourtant, ces agents et hauts fonctionnaires ont été démasqués par les autorités de contrôle. Et cela après le 3 août 2005. « Nul n’est sensé ignorer la loi, les prédateurs de bien du peuple ne devront pas occuper des postes sensibles, même s’ils remboursent ce qu’ils ont déjà détourné. » explique un ardent défenseur de la cause juste.
Au niveau administratif, les choses n’ont pas forcement évolué. Le contrôle de prix pourtant nécessaire pour l’amélioration du niveau de vie est quasiment inexistant. L’exemple rassurant les citoyens demeure celui de la restitution des centaines de millions d’ouguiyas détournés aux dépens de l’Etat. Les autorités publiques viennent de bénéficier de plusieurs ressources.
Citons entre autres : la contribution financière de l’Union Européenne d’un montant total de 540millions d’Euros étalés sur 6 ans soit 108 millions d’euros par an. Ce nouvel accord de pêche est interprété par Bruxelles comme étant « le plus important accord de pêche avec un pays tiers, en terme financiers. Le nouveau partenariat apportera un bénéfice mutuel à l’UE et à la Mauritanie en termes d’emplois, de renforcement du contrôle et de la surveillance, de préservation des ressources et de la protection de l’environnement.» Ajoutons à cela, les 100 millions de dollars provenant de la part de la Mauritanie dans la production pétrolière et l’annulation des services de la dette qui permet au pays d’économiser 25 millions de dollars.
A qui profite ces sommes ?
Malgré l’augmentation des salaires de 50 % pour les fonctionnaires, 15 % pour les retraités et une réduction des impôts, les mauritaniens moyens commencent à perdre espoir, car les analystes prévoient une augmentation de 300 %, régulés par la reprise économie. Comment ?
Les spécialistes sont unanimes sur la réduction de la pauvreté et la restructuration économique.
En 2000, et d’après les données du recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), le taux de chômage se chiffrait à 19%, soit environ 145000 personnes. Les données de l’Office National de la Statistique (ONS), réalisées sur les conditions de vie des ménages (EPCV), ont permis de revoir à la hausse ce taux. Il avoisine désormais les 30%. Ainsi, 57 % de la catégorie socioprofessionnelle sont indépendants. Les emplois salariés demeurent inférieurs à 20 %, alors que les allocations familiales représentent 6 % en 2000.
Notons que l’informel qui est de 87 % grappille de plus en plus dans les milieux urbains au détriment de l’emploi dans les zones rurales.
Sil l’on se réfère aux deux derniers recensements de 1998 et de 2000, on constate une nette croissance de 3,7% par an. Ce qui équivaut à une moyenne de 16000 emplois supplémentaires par année. Les diagnostics de l’ANAPEJ explique que « le fait que cette croissance coïncide avec une période de montée du phénomène de pauvreté laisserait à penser qu’il s’agit dans beaucoup de cas d’emplois précaires et/ ou peu rémunérateurs recouvrant un chômage déguisé. Cette précarité taraude les esprits des économistes dont la seule solution réside dans la croissance.
Plus d’activité signifie, moins de chômage. Plus de production signifie plus de revenus à distribuer… D’où une nouvelle politique d’emploi qui doit se baser sur des divergences portant sur les moyens de la reprise, et sur la place des pauvres dans la relance. Ces désaccords épineux et difficiles à réconcilier restent inexistants dans le débat politique en Mauritanie.
En effet, les autorités tablent sur une croissance économique allant jusqu’à 26% voire 45%. Quelles seront les politiques à venir ?
Bien que le changement a eu lieu, les mauritaniens n’ont pas ressenti ses effets. Des «paroles» laissent entendre un pessimiste. Les indicateurs économiques sont toujours au rouge et les perspectives floues, dit-on par ci par là , en ville.
Pour ce qui est de l’emploi, on parle des 500 jeunes profitant chacun d’un prêt avoisinant 900 mille ouguiyas et un éventuel consentement de 100 crédits supplémentaires. Ces crédits semblent être insignifiants pour réaliser des investissements rentables. Le gouvernement de transition ne cherche pas à intégrer les diplômés chômeurs. Dans les annonces d’emploi, il faut disposer d’une expérience de cinq ans voire plus. «On ne naît pas avec l’expérience », martèle des chômeurs mécontents de se voir refuser pour manque de grande expérience. Par ailleurs, qu’en est- il de l’engagement politique ?
Les prévisions sont loin d’être une préoccupation politique au sein du gouvernement. En pratique, on fait croire chaque fois qu’il y a de nouveaux revenus, les citoyens vont en profiter.
« Des programmes politiques qui se ressemblent, guidés par des chefs de partis se focalisant de plus en plus sur l’électorat au détriment du bien être social, seront qu’une perte de temps», affirme un éminent cadre. A qui incombe la faute? Aux citoyens dupés par les besoins du moment ?
Peut-on parier sur des politiques qui ne disposent pas d’indicateurs prospectifs ? Ne devait-on pas exiger une modification constitutionnelle excluant les analphabètes des élections ? Prenons le cas des objectifs de la lutte contre l’analphabétisme. La vision est simple : un taux de scolarisation de 91,7%, alors la qualité est presque nulle. Qui peut arrêter cette comédie ?
Mohamed Fouad Barrada
|