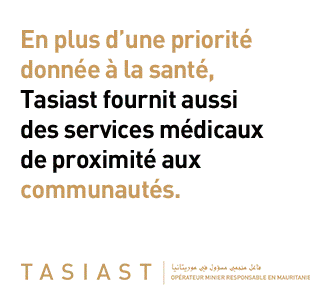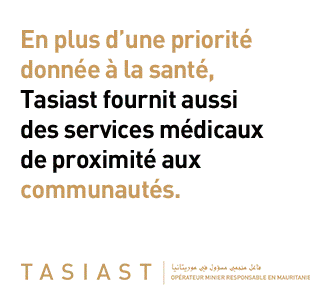Le parti de l’ALTERNATIVE (El Bédil) présidé par Mohamed Yehdhih Ould Moctar El Hacen (ancien SG de l’ex-Prds et ministre de l’intérieur du Président Sidi Ould cheikh Abdellahi) apporte ici sa contribution aux «Etats Généraux de la Démocratie»(EGD) qui se tiennent à partir du 27 décembre à Nouakchott, pour trouver une sortie de crise à l’impasse consécutive au putsch du 6 août.
Fervent soutien de la «Rectification» (coup d’Etat du 6 août), ce parti estime néanmoins «inopportun», d’envisager des modifications constitutionnelles.
«Aucun mode de gestion politique ne doit conduire (…) à l’affaiblissement de l’institution présidentielle, la crise actuelle est d’abord le résultat non pas de l’autoritarisme mais plutôt des errements et de l’inconstance de l’ancien pouvoir» estime l’ALTERNATIVE. Ce parti qui tient à voir l’Armée jouer un rôle politique propose en se fondant sur les dispositions de l’art 34 de la Constitution, la création, d’un «Conseil Supérieur de la Défense Nationale (CSDN) dont les compétences couvriront l’ensemble des questions de défense et de sécurité mais aura également à se prononcer sur toutes les grandes questions d’intérêt national ».
L’ALTERNATIVE propose également l’interdiction des candidatures indépendantes et veut ainsi lutter contre le nomadisme politique dont ce parti fut victime.
«Tout mandat dont le titulaire désire changer d’appartenance partisane doit être remis en jeu et des élections partielles organisées à cet effet» lit-on.
Il faut rappeler que l’unique député de l’ALTERNATIVE l’avait déserté pour les bienfaits de la fronde parlementaire au moment même où le président de ce parti était ministre de l’Intérieur du gouvernement contesté par une fronde soutenue par les Militaires contre le président Ould Cheikh Abdellahi, renversé le 6 août.
Concernant l’organisation des futures élections, L’ALTERNATIVE avance deux hypothèses : leur supervision par le HCE (junte au pouvoir), si aucun de ses membres n’est candidat, ou par un «gouvernement de transition neutre» et par le président du Sénat, au cas où l’un des membres du HCE est candidat.
Ci-dessous l’intégralité de contribution de l’ALTERNATIVE aux «Etats Généraux de la Démocratie»
PARTI DE L’ALTERNATIVE :
Contribution aux «Etats Généraux de la Démocratie»
I. Introduction
Dans le débat qui commence aujourd’hui à l’occasion des Etats Généraux de la Démocratie (EGD) et dont les enjeux sont rien de moins que la Mauritanie et son avenir ; il nous semble, à l’Alternative, impossible, que chaque parti, loin de toute démagogie et dans la clarté n’apporte pas sa contribution à cette importante et nécessaire réflexion.
Notre démocratie, examinée à l’aune de ses résultats est un échec : Au plan politique, la volonté manifeste, clairement affichée, de tous les pouvoirs de contourner et de fragiliser les partis, l’instabilité et la confusion qui en ont résulté, a entretenu une situation permanente de défiance et parfois de crise et réduit considérablement le rôle de ces formations pourtant indispensable dans toute démocratie.
En érigeant le clientélisme en méthode de gouvernement, en battant à chaque fois le rappel de « l’armée de réserve », toujours prompte à condamner à l’emporte-pièce et à encenser sans retenue, ces mêmes pouvoirs ont renforcé et pérennisé les influences néfastes, tribales et claniques…et laissé le champ libre à l’activisme des groupuscules et lobby traditionnels.
Autant de choses, qui, des décennies durant, ont empêché l’émergence d’une classe politique nationale digne de ce nom, détournant ainsi le pays des véritables enjeux.
En dépit de quelques avancées en matière de libertés, la situation en matière d’égalité, de justice sociale, de progrès économique et de développement est demeurée, dans le pays, préoccupante.
Dans le domaine de la sécurité, le terrorisme, l’immigration illégale et les trafics crapuleux semblent avoir durablement investi le pays.
Cet échec de la démocratie et celui consécutif des politiques publiques dans le domaine économique et social consacre l’échec de la classe politique et par ses interventions successives celui du pouvoir militaire.
II. Les principes généraux qui fondent notre action
- La Mauritanie est une nation citoyenne, riche par sa diversité culturelle, que fonde sa commune religion, sa communauté de territoire de vie et de destin.
Cette nation, mise en mouvement par un état républicain, juste et égalitaire, est le meilleur rempart contre les dérives extrémistes et chauvines des nationalismes primaires.
L’appartenance à la nation mauritanienne offre à tous les citoyens, sans distinction aucune, un modèle républicain d’identification assorti des mêmes devoirs et des mêmes droits.
- La démocratie est un choix capital : le modèle qui plus que tout autre donne tout son sens et toute sa plénitude à cette citoyenneté ;
- En matière économique : le libéralisme, l’encouragement de l’initiative privée assujettis à une régulation souple, appropriée et non contraignante ;
- Au plan social : solidarité nationale et valorisation du travail
III. RĂ©flexions et propositions
1. Au plan institutionnel
a/ Même si nous croyons utile que soient revues l’étendue et la consistance des pouvoirs et des responsabilités du Premier Ministre et des majorités qui gouvernent, il nous semble, aujourd’hui inopportun, dans un contexte de crise, d’envisager des modifications
constitutionnelles.
En tous les cas aucun mode de gestion politique ne doit conduire, dans notre pays, à la dilution de l’autorité de l’état et à l’affaiblissement de l’institution présidentielle.
La crise actuelle est d’abord le résultat non pas de l’autoritarisme mais plutôt des errements et de l’inconstance de l’ancien pouvoir. Il faut en tirer les bonnes leçons et éviter, en particulier, en généralisant à partir d’une situation exceptionnelle, d’abaisser le Président de la république Chef de l’état qui est la clef de voûte de
nos institutions.
b/ Rôle et place de l’institution militaire
L’institution militaire a joué un rôle important dans notre histoire politique de ces 30 dernières années. Les historiens avec le recul nécessaire évalueront et jugeront quelles furent les conséquences de cette implication sur le parcours de la Mauritanie au cours de cette
période. Associer l’armée à la gestion du pays demeure encore aujourd’hui un gage de la stabilité indispensable à toute entreprise de développement.
Cette association, qui prendra le temps nécessaire à bâtir une armée de métier, un outil aux capacités défensives avérées, à valoriser au plan moral et matériel l’appartenance à cette importante institution nationale, sera conçue sans frilosité et sans a-priori de pensée.
A cet effet Notre parti préconise la démarche suivante :
Au préalable un certain nombre de réformes de structures nous semblent indispensables pour faire face, avec plus d’efficacité aux impératifs actuels en matière de sécurité et de défense du territoire :
- Développement des armes de la marine et de l’aviation et création d’un état-major pour chacune de ces armes
- Création d’un ministère chargé de la sécurité et ayant autorité sur la police nationale, la gendarmerie et la garde, chacune érigée en direction générale. Les compétences du ministère de l’intérieur couvriront l’administration territoriale, les collectivités et l’aménagement du territoire.
- Création d’un état-major inter-armes supervisant les état-majors de l’armée de terre, de la marine et de l’aviation.
Proposition : En se fondant sur les dispositions de l’art 34 de la constitution on procèdera par loi organique à la création, à l’organisation et au fonctionnement d’un conseil supérieur de la
Défense Nationale (CSDN) dont les compétences couvriront l’ensemble des questions de défense et de sécurité mais aura également à se prononcer sur toutes les grandes questions d’intérêt national.
Trois Comités de défense nationale (CDN) dont la composition et les compétences seront arrêtées par le CSDN, aideront à la prise de décision dans ces différents domaines :
Un Comité de Défense Nationale (CDN) pour les questions de sécurité
Un Comité de Défense Nationale (CDN) pour les questions liées aux
problèmes politiques, institutionnels et des relations extérieures
Un Comité de Défense Nationale (CDN) pour les questions économiques
et sociales.
Le CSDN sera présidé par le président de la République et comprendra :
- Le Premier Ministre
- Le ministre de la DĂ©fense
- Le ministre chargé de la sécurité
- Le ministre de l’Intérieur
- Le chef de la majorité politique (un texte précisera les modalités
de sa désignation)
- Le chef de l’opposition politique
- Le chef d’état-major inter-armes
- Les différents chefs d’état major des armées (terre, mer et air)
- Les directeurs généraux de la police, de la garde et de la gendarmerie
2. Au plan politique
Le renforcement et la reconnaissance du rôle des partis politiques est lui aussi un gage de stabilité. L’accès aux fonctions politiques publiques (sauf exception), l’appartenance à la représentation nationale (députés, sénateurs, maires,…..) doit être et rester, dans toute démocratie l’apanage des Partis politiques. C’est d’ailleurs ainsi que la constitution l’a prévu (Art 11).
Pour ce faire trois mesures importantes doivent être arrêtées :
- Interdiction des candidatures indépendantes
Toute candidature aux élections législatives et municipales doit émaner des partis politiques légalement reconnus.
- Afin d’éviter que le choix des électeurs ne soit détourné, afin d’encourager dans notre pays l’éclosion de mœurs politiques convenables, tout mandat dont le titulaire désire changer
d’appartenance partisane doit être remis en jeu et des élections partielles organisées à cet effet.
- Les changements intervenus au niveau de l’élection des maires a entraîné une grande instabilité des conseils municipaux et partant, réduit l’efficacité de la gestion communale. Afin d’éviter une dilution de la responsabilité politique et assurer une certaine continuité, le maire devra appartenir obligatoirement à la liste arrivée en tête.
Il conviendra également de limiter, au moins dans les élections municipales, le champ d’application de la proportionnelle qui n’a eu comme conséquence que rendre encore plus difficile l’apparition d’une majorité suffisante au sein des conseils municipaux.
3- Au plan Ă©conomique
le principal enseignement que l’on peut tirer des décennies écoulées est que « la politique de la demande » recommandée en priorité par le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) n’a pas suffi à amorcer le développement dans notre pays.
Il convient certes de maintenir une politique budgétaire modérée et éviter tout endettement excessif mais il est de plus en plus évident « qu’une politique de l’offre » c’est-à -dire une politique volontariste des structures destinées à favoriser la production, l’investissement
et l’exportation doit désormais constituer l’axe principal de notre orientation économique.
Cette « politique de l’offre » doit privilégier (pour des raisons évidentes d’emploi, de revenus et de production alimentaire), les secteurs de l’agriculture et des pêches et permettre une plus grande intégration de l’élevage dans les circuits marchands.
Une loi concertée d’orientation et de modernisation de l’économie doit permettre de fixer ces choix et esquisser les contours des autres ajustements nécessaires : (désinformalisation de l’économie, mise à niveau des entreprises, assainissement des secteurs financier et
bancaire, …)
4- Au plan social
Le « changement », viatique éculé de tous les pouvoirs, ne suffit pas, à lui seul, à rendre le pays plus prospère et assurer aux mauritaniens des conditions de vie meilleures.
Il faut s’y résoudre ; le traitement social du chômage et de la pauvreté a des limites ; les décisions sociales courageuses et l’assistanat, pour louables qu’ils soient, produisent inévitablement un retour de flamme dont il faut en permanence se méfier.
Il reste cependant incontestable que la grande majorité des mauritaniens, en dépit d’un potentiel économique important, est aujourd’hui pauvre et qu’il est urgent, sous peine de mettre en péril la cohésion sociale, d’apporter des réponses efficaces et durables à a précarité dans laquelle vit une grande partie de nos concitoyens.
Une loi concertée portant « pacte de solidarité nationale »devrait permettre de mobiliser les moyens et de fixer les champs d’interventions prioritaires.
En ressources : Les moyens seront ceux de l’état, de la communauté nationale et des dons extérieurs (état, dons, fondations, prélèvements, Zakat, Awqaf…) avec introduction à une large échelle de la micro-finance (CAPEC) dans au moins 500 localités dont les 216 chefs lieux de communes.
En emplois: Santé, éducation, ménages précaires, produits de première
nécessité etc.…….
IV. CONCLUSION
Nous l’avons déjà dit, le pays est à la croisée des chemins ; sans improvisation ni précipitation, nous devons tous nous employer à asseoir notre système politique sur des bases saines et solides qui lui assurent la pérennité et permettront d’avoir la stabilité nécessaire pour engager le pays sur la voie du progrès et de la prospérité.
L’élection de mars 2007 a suscité de grands espoirs dans le pays. Pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, ces espoirs ont été déçus. L’armée a été à l’origine du processus historique engagé à l’occasion de ces élections; on ne peut se féliciter hier de son
intervention et se plaindre aujourd’hui de son retour lorsqu’il est devenu évident que ce processus a été dévoyé.
Une nouvelle transition est encore aujourd’hui indispensable, elle prendra le temps nécessaire pour engager les réformes politiques préconisées, débattre et faire approuver les textes de lois portant sur les différents domaines évoqués.
Au-delà des péripéties actuelles, cette transition devra, à son terme, aboutir à une alternance historique, longtemps différée, entre un pouvoir militaire exercé sans interruption depuis trente ans (non-nobstant la tentative avortée de 2007) et un pouvoir civil tourné vers l’avenir et préoccupé par trouver des réponses appropriées aux diverses attentes des mauritaniens.
Ce pouvoir, qui établira avec l’institution militaire des relations de confiance, décomplexées, sera issu d’élections libres et transparentes organisées par une administration dont la neutralité est sans équivoque et dont les résultats seront reconnus à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour organiser et superviser ces élections deux hypothèses sont envisageables
:
a. Aucun membre du HCE n’étant candidat à l’élection présidentielle; le HCE est tout indiqué pour gérer la transition et organiser les élections.
b. Un membre du HCE est candidat à l’élection présidentielle ; dans ce cas le HCE et le gouvernement qui en est issu ne sont plus habilités à organiser et à superviser les élections.
Dans cette dernière hypothèse le processus électoral se déroulera selon le schéma ci-après :
Le Conseil Constitutionnel, constate l’empêchement et arrête la date des élections (Art 40 et 41 de la constitution).
Immédiatement un gouvernement neutre de transition, accepté par les différentes forces politiques est constitué ; il aura la charge d’organiser et de superviser les élections.
Une fois ce gouvernement constitué, le Président du Sénat est installé pour assurer l’intérim du président de la république (Art 40 de la constitution).
Le Président de la république intérimaire se fera assister dans sa mission par le CSDN.
La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est réactivée et rendue opérationnelle par le nouveau gouvernement.
NOUAKCHOTT LE 24 DECEMBRE 2008
Le comité Permanent
|