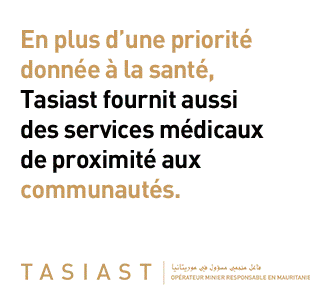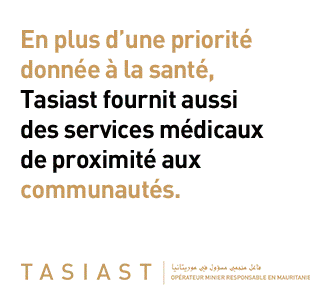À la tĂŞte du Tchad depuis 1990, le prĂ©sident Idriss DĂ©by Itno est dĂ©cĂ©dĂ© mardi des suites de blessures reçues au combat contre des rebelles. DĂ©criĂ© dans son pays, le chef de l’État avait su gagner la confiance des Occidentaux en se plaçant Ă la pointe de la lutte anti-terroriste. Portrait.
Il avait troquĂ© son boubou pour une cape de soie bleu nuit brodĂ©e de feuilles de chĂŞne en fil d’or, bâton "modèle Empire" en main. C’était le 11 aoĂ»t 2020, lors d’une cĂ©rĂ©monie : il Ă©tait Ă©levĂ© au rang de "MarĂ©chal du Tchad". Idriss DĂ©by Itno est mort mardi 20 avril de blessures reçues sur le champ de bataille contre une colonne de rebelles infiltrĂ©s dans le nord depuis leurs bases arrières en Libye, a annoncĂ© mardi l’armĂ©e Ă la tĂ©lĂ©vision d’État, au lendemain de la proclamation de sa rĂ©Ă©lection pour un sixième mandat Ă la tĂŞte du pays lors de la prĂ©sidentielle du 11 avril. Ce fils d’éleveur modeste, militaire de carrière et combattant rebelle, s’est emparĂ© du pouvoir par un coup d’État en 1990 : il n’avait de cesse de se prĂ©senter comme un "guerrier". C’est cette image, façonnĂ©e depuis ses premières armes aux cĂ´tĂ©s de Hissène HabrĂ© - qui avait pris le pouvoir en 1982 - jusqu’au treillis qu’il enfilait encore volontiers ces dernières annĂ©es, qui lui a valu un soutien quasi unanime de la communautĂ© internationale, malgrĂ© un bilan très critiquĂ© en matière de droits humains. Au sein du pouvoir, Idriss DĂ©by rĂ©gnait volontiers par l’"intimidation" et le nĂ©potisme, selon ses dĂ©tracteurs. Il avait placĂ© sa famille ou des proches Ă des postes-clĂ©s de l’armĂ©e, de l’appareil d’État ou Ă©conomique, et ne laissait jamais les autres longtemps en place. Dix-sept Premiers ministres se sont succĂ©dĂ© entre 1991 et 2018, avant qu’Idriss DĂ©by ne fasse supprimer cette fonction pour ravir toutes les prĂ©rogatives de l’exĂ©cutif. "Tout est centralisĂ© Ă la prĂ©sidence, il use de toutes les armes du pouvoir absolu en brutalisant la sociĂ©tĂ©", avance Roland Marchal, chercheur au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po Paris. À la pointe de la lutte anti-terroriste RĂ©gulièrement contestĂ© dans son pays, Idriss DĂ©by Itno bĂ©nĂ©ficiait de la confiance de ses partenaires africains et occidentaux. Celui qui a assurĂ© la prĂ©sidence de l’Union africaine (UA) en 2016 avait acquis ces dernières annĂ©es une stature de premier plan en positionnant sa redoutable armĂ©e Ă la pointe de la lutte contre le terrorisme. En première ligne aux cĂ´tĂ©s des soldats français, ses troupes sont parties Ă l’assaut des jihadistes du Nord-Mali en 2013, puis sont intervenues en 2014 en Centrafrique avant de se retirer Ă la suite d’accusations d’exactions. Sur le front de la lutte contre Boko Haram, l’armĂ©e tchadienne a lancĂ©, au dĂ©but de 2015, une vaste offensive au Cameroun, au Nigeria et au Niger contre les islamistes armĂ©s de la secte nigĂ©riane qu’Idriss DĂ©by de "horde d’illuminĂ©s et de droguĂ©s". Cette dĂ©testation de longue date des jihadistes Ă©tait d’ailleurs un trait de caractère de ce "gendarme du Sahel", musulman, dans un pays oĂą les chrĂ©tiens forment plus d’un tiers de la population. À l’heure de la mobilisation internationale contre les groupes terroristes, ses interventions lui valaient de solides appuis chez les Occidentaux, particulièrement en France, ancienne puissance coloniale et alliĂ©e de longue date. Mais Ă N’Djamena, ce soutien plus qu’appuyĂ© inquiĂ©tait certains. Dès 2014, le chef de file de l’opposition, Saleh Kebzabo, candidat malheureux avec 12,8 % des suffrages, demandait "instamment aux partenaires Ă©conomiques du Tchad, en particulier la France, d’être de plus en plus exigeants sur la gouvernance Ă©conomique, le respect des droits humains" face Ă un "rĂ©gime qui a acculĂ© la population Ă une paupĂ©risation croissante et excelle dans la gestion patrimoniale de l’État". Illustration de la lassitude et du malaise social chez une partie de la population, des manifestations - interdites - de la sociĂ©tĂ© civile l’avaient appelĂ© Ă ne pas se reprĂ©senter avant la prĂ©sidentielle du 11 avril. S’il laissait certains de ses opposants s’exprimer relativement librement, ses services veillaient consciencieusement Ă ne pas laisser la critique gagner la rue, par des interpellations ciblĂ©es et en interdisant tout rassemblement politique. Un destin liĂ© Ă celui d’HabrĂ© Pour le chef de l’État tchadien, la vie Ă©tait une succession de combats. NĂ© en 1952 Ă Berdoba (nord-est) dans une famille zaghawa, une branche du groupe gorane, prĂ©sente de part et d’autre de la frontière tchado-soudanaise, il se destine dès le plus jeune âge au mĂ©tier des armes. BaccalaurĂ©at en poche, il entre Ă l’école d’officiers de N’Djamena, puis dĂ©croche en France son brevet de pilote. RentrĂ© au pays, il lie son destin Ă celui d’Hissène HabrĂ© - condamnĂ© en 2016 pour crimes contre l’humanitĂ© - qui prend le pouvoir en 1982. Commandant en chef des armĂ©es, Idriss DĂ©by voit son aura croĂ®tre avec la guerre de "reconquĂŞte" qui permet au Tchad de reprendre le Nord occupĂ© par les Libyens. Conseiller militaire du prĂ©sident, il est accusĂ© de complot en 1989 et s’enfuit en Libye, puis au Soudan. Il y fonde sa propre armĂ©e, le Mouvement patriotique du salut (MPS). En dĂ©cembre 1990, ses troupes prennent N’Djamena. Au pouvoir, il ouvre le pays au multipartisme. Élu en 1996 et rĂ©Ă©lu depuis, il est critiquĂ© par une opposition qui lui reproche des fraudes Ă©lectorales, des violations des droits de l’Homme et, malgrĂ© son entrĂ©e en 2003 dans le club des pays producteurs de pĂ©trole, l’extrĂŞme pauvretĂ© des Tchadiens. C’est grâce Ă l’armĂ©e que ce militaire a assis son pouvoir. EncadrĂ©e essentiellement par des officiers de son ethnie zaghawa et commandĂ©e par ses proches, elle est considĂ©rĂ©e comme une des meilleures de la rĂ©gion. Mais ces derniers mois, l’unitĂ© des Zaghawas s’est Ă nouveau fissurĂ©e, et le chef de l’État a dĂ» Ă©carter certains officiers "douteux", selon des proches du Palais. DĂ©jĂ Ă la fin des annĂ©es 2000, cette unitĂ© avait Ă©tĂ© sĂ©rieusement malmenĂ©e, des Zaghawas passant dans le camp de la rĂ©bellion, notamment Timan Erdimi : ce neveu d’Idriss DĂ©by prend en 2008 la tĂŞte d’une coalition rebelle qui Ă©choue, aux portes du palais prĂ©sidentiel de N’Djamena, Ă renverser le prĂ©sident. De source militaire, la France avait alors proposĂ© au prĂ©sident de l’évacuer. Il avait refusĂ©, jurant de garder le pouvoir, ou de mourir, armes Ă la main. Cette attaque est une des ombres du long parcours du prĂ©sident-soldat : dans la confusion de l’après-combat, un des principaux opposants, Ibni Oumar Mahamat Saleh, avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© par les forces de sĂ©curitĂ©. PortĂ© "disparu", il est depuis donnĂ© pour mort.
"Ami encombrant de la France"
Une nouvelle offensive rebelle très menaçante pour le pouvoir est lancĂ©e en 2019 mais est stoppĂ©e loin de N’Djamena par des bombardements dĂ©cisifs d’avions de combat français. C’est, au final, en tenant bon grĂ© mal grĂ© son pays, entourĂ© d’États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan, qu’Idriss DĂ©by apparaĂ®t comme l’élĂ©ment stabilisateur d’une rĂ©gion tourmentĂ©e. Mais le pays paye un lourd tribut Ă la lutte contre les jihadistes. Le groupe nigĂ©rian Boko Haram multiplie les attaques meurtrières autour du lac Tchad, contraignant Idriss DĂ©by Ă remettre le treillis pour mener lui-mĂŞme - au moins devant les mĂ©dias - une contre-offensive jusqu’en territoire nigĂ©rian en mars-avril 2020. L’"ami encombrant de la France" et des Occidentaux, comme le qualifient nombre d’experts de la rĂ©gion, avait su se rendre indispensable Ă leurs yeux contre les jihadistes. FRANCE 24 Avec AFP
|